
En France, les congés ne sont pas qu’un simple moment de détente : ils font partie intégrante des droits des salariés et de l’organisation de l’entreprise. Derrière les congés payés, les jours fériés ou encore les congés familiaux, se cache un ensemble de règles parfois complexes, où se mêlent Code du travail, conventions collectives et pratiques d’entreprise.
Ce guide a pour but de rendre ces règles claires et accessibles. Comment se calculent les congés payés ? Quelles sont les spécificités des congés maternité ou sabbatiques ? Dans quelles conditions un employeur peut-il refuser une demande ? Autant de questions auxquelles nous allons répondre simplement, avec des exemples concrets, des repères pratiques et quelques astuces utiles.
Les congés, en 2026, ce n’est pas seulement une affaire de calendrier : c’est surtout un levier d’équilibre entre vie professionnelle et personnelle.
| Type de congé | Durée légale / usuelle | Rémunération | Conditions principales |
|---|---|---|---|
| Congés payés | 30 jours ouvrables par an (5 semaines) | Oui (indemnité) | 2,5 jours/mois de travail effectif |
| Jours fériés | 11 par an | Oui (sauf exceptions) | 1er mai obligatoirement chômé et payé |
| RTT | 10 à 12 jours/an selon durée de travail | Oui | Heures travaillées au-delà de 35h/semaine |
| Congé maternité | 16 semaines minimum | Indemnités Sécu + complément | Automatique |
| Congé paternité | 25 à 32 jours | Indemnités Sécu | 7 jours obligatoires |
| Congé parental | Jusqu’à 3 ans | Allocation CAF | Ancienneté d’1 an |
| Congés exceptionnels | 1 à 4 jours | Oui | Mariage, décès, naissance, etc. |
| Jour de solidarité | 1 jour/an | Travaillé sans rémunération supplémentaire | Fixé par employeur |
| Congé sabbatique | 6 à 11 mois | Non | 36 mois d’ancienneté requis |
| Congé création d’entreprise | Jusqu’à 1 an (renouvelable 1 fois) | Non | 24 mois d’ancienneté requis |
Qu’est-ce qu’un congé ? Définition et cadre légal
Le mot congé désigne une période pendant laquelle un salarié, avec l’accord de son employeur, est autorisé à interrompre son activité professionnelle. Contrairement à une simple absence, le congé est encadré par le Code du travail ou par des accords collectifs, et il ouvre le plus souvent un droit à rémunération.
On pense immédiatement aux vacances d’été ou aux congés payés, mais la réalité est beaucoup plus large. Le droit français distingue en effet plusieurs catégories :
- des congés liés au repos et à la récupération (congés payés, RTT, jours fériés),
- des congés pour des raisons personnelles ou familiales (maternité, paternité, parental, mariage, décès),
- des congés pour projets spécifiques (formation, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise).
Cette diversité traduit une logique simple : offrir aux salariés des temps de repos, de protection ou de développement personnel, tout en maintenant un cadre clair pour l’employeur qui doit organiser l’activité de l’entreprise.
Sur le plan juridique, tout congé doit répondre à trois critères essentiels :
Une articulation avec le contrat de travail : les congés ne suspendent pas les droits fondamentaux du salarié (ancienneté, protection sociale), sauf cas particuliers comme le congé sans solde.
Un cadre légal ou conventionnel : la base est fixée par le Code du travail, mais chaque convention collective peut prévoir des dispositions plus favorables.
Un accord ou une procédure : certains congés sont automatiques (maternité, paternité), d’autres nécessitent une demande préalable et l’accord de l’employeur (sabbatique, création d’entreprise).
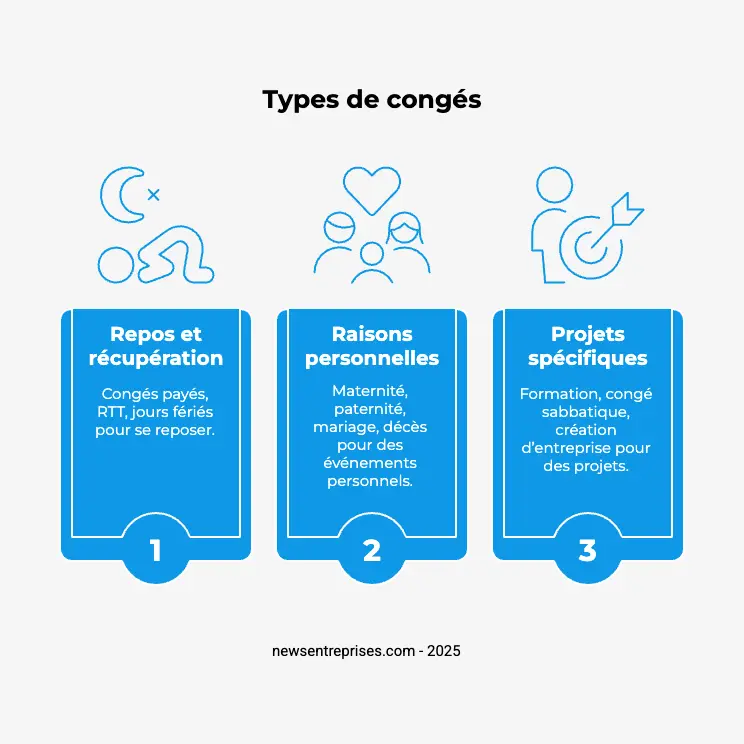
Congés payés : droits, calcul et indemnisation
Les congés payés sont la forme la plus connue et la plus utilisée de congés en France. Ils constituent un droit fondamental pour tous les salariés, qu’ils soient en CDI, en CDD, en intérim ou en apprentissage. Instaurés en 1936, ils reposent sur un principe simple : permettre à chaque salarié de bénéficier d’un temps de repos tout en étant rémunéré.
Les droits acquis
Chaque salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables par an, c’est-à-dire 5 semaines de repos.
Certaines conventions collectives ou accords d’entreprise prévoient des avantages supplémentaires, comme des jours offerts en plus, des congés liés à l’ancienneté ou un système de fractionnement.
Calcul et période de référence
L’acquisition des congés se fait sur une période de référence fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Ainsi, un salarié embauché en janvier commence à cumuler des droits qu’il pourra utiliser dès l’été si son employeur autorise les congés par anticipation.
Deux notions essentielles encadrent le décompte :
- Jours ouvrables : tous les jours de la semaine, du lundi au samedi inclus, à l’exception des jours fériés.
- Jours ouvrés : uniquement les jours habituellement travaillés dans l’entreprise, généralement du lundi au vendredi.
Cette distinction entre jours ouvrables et jours ouvrés est déterminante dans le calcul du solde de congés.
| Critère | Jours ouvrables | Jours ouvrés |
|---|---|---|
| Définition | Du lundi au samedi inclus, sauf jours fériés | Jours effectivement travaillés dans l’entreprise (souvent du lundi au vendredi) |
| Nombre de jours par semaine | 6 jours | 5 jours |
| Exemple d’une semaine complète de congés | 6 jours décomptés (lundi → samedi) | 5 jours décomptés (lundi → vendredi) |
| Exemple d’un vendredi posé | Vendredi + samedi = 2 jours décomptés | 1 seul jour décompté |
Indemnisation et maintien de salaire
Pendant ses congés, le salarié perçoit une indemnité compensatrice de congés payés. Deux méthodes de calcul sont prévues par la loi :
- Règle du maintien de salaire : le salarié touche exactement la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé.
- Règle du dixième : l’indemnité correspond à un dixième de la rémunération brute perçue au cours de la période de référence.
Exemples de calcul :
- Un salarié payé 2 000 € brut par mois prend une semaine de congés : il touchera 2 000 € pour ce mois selon la règle du maintien de salaire.
- Le même salarié a perçu 24 000 € brut sur la période de référence. Son indemnité calculée selon la règle du dixième est de 2 400 € pour 5 semaines de congés.
Exemple de calcul avec maintien de salaire :
Un salarié payé 2 000 € brut par mois prend une semaine de congés.
Il percevra 2 000 € pour ce mois, car son salaire est maintenu intégralement.
Exemple de calcul avec la règle du dixième :
Le même salarié a perçu 24 000 € brut sur la période de référence (12 mois).
Son indemnité de congés payés est égale à 1/10e, soit 2 400 € pour 5 semaines de congés.
Points de vigilance
- Les congés doivent obligatoirement inclure une période principale prise entre le 1er mai et le 31 octobre.
- L’employeur fixe les dates en tenant compte des nécessités de service, mais doit respecter un délai de prévenance, souvent fixé à un mois.
- Les congés payés ne peuvent être remplacés par une indemnité, sauf en cas de rupture du contrat de travail.
Jours fériés et ponts : optimiser vos congés en 2026
En France, il existe 11 jours fériés légaux chaque année. Ils représentent autant d’occasions de repos supplémentaires pour les salariés, mais leurs modalités d’application varient selon les entreprises et les conventions collectives. Contrairement aux congés payés, les jours fériés ne s’acquièrent pas : ils sont accordés de plein droit par la loi, sauf exceptions.
Les 11 jours fériés nationaux
Parmi eux figurent le 1er janvier, le 1er mai, le 14 juillet ou encore le 25 décembre. Tous les salariés, qu’ils soient en CDI, en CDD ou en intérim, sont concernés. Le 1er mai bénéficie d’un statut particulier : il est obligatoirement chômé et payé. Pour les autres jours, un accord de branche ou une convention collective peut prévoir des modalités différentes, notamment pour les secteurs où le travail ne peut pas être interrompu (hôtellerie, santé, transports).
Impact sur les congés payés
Lorsqu’un jour férié tombe pendant une période de congés payés, il ne doit pas être décompté du solde du salarié. Par exemple, un salarié en congé du lundi au dimanche incluant le 15 août 2026 (jour férié) ne verra pas ce jour retranché de son nombre de jours acquis. Cette règle, souvent mal comprise, est une protection essentielle pour éviter la perte de droits.
L’art du « pont »
L’un des avantages stratégiques des jours fériés réside dans la possibilité de « faire le pont ». Concrètement, lorsqu’un jour férié tombe un jeudi ou un mardi, l’entreprise peut autoriser les salariés à prendre le vendredi ou le lundi en repos. Cela permet de transformer un seul jour posé en un long week-end de quatre jours.
En 2026, le calendrier présente des opportunités intéressantes, bien que certains jours fériés tombent en week-end. Neuf jours fériés sur onze tombent en semaine, offrant plusieurs occasions de ponts :
Le pont du Nouvel An : le 1er janvier 2026 tombe un jeudi. En posant le vendredi 2 janvier 2026, vous bénéficiez de quatre jours de repos consécutifs.
Les week-ends prolongés de mai : le mois de mai 2026 offre trois week-ends prolongés naturels. Le 1er mai 2026 tombe un vendredi, tout comme le 8 mai 2026, créant deux week-ends de trois jours sans poser de congé. Le jeudi 14 mai 2026 (Ascension) permet de faire un pont classique en posant le vendredi 15 mai 2026 pour profiter de quatre jours de repos. Le lundi de Pentecôte (25 mai 2026) offre également un week-end prolongé naturel.
Le pont du 14 juillet : la fête nationale tombe un mardi (14 juillet 2026). En posant le lundi 13 juillet 2026, vous transformez ce jour férié en un week-end de quatre jours, idéal pour lancer les grandes vacances d’été.
Le pont du 11 novembre : l’Armistice tombe un mercredi (11 novembre 2026). Vous pouvez choisir de poser le mardi 10 novembre 2026 pour un week-end prolongé de quatre jours, ou d’opter pour une stratégie plus ambitieuse en posant les lundi 9 et mardi 10 novembre 2026 pour cinq jours de repos consécutifs.
Le pont de Noël : le 25 décembre 2026 tombe un vendredi, offrant naturellement un week-end de trois jours. En posant le jeudi 24 décembre 2026, vous pouvez bénéficier de quatre jours de repos.
À noter que deux jours fériés tombent en week-end en 2026 : le samedi 15 août 2026 (Assomption) et le dimanche 1er novembre 2026 (Toussaint), ce qui réduit légèrement les opportunités de repos pour les salariés travaillant du lundi au vendredi.
📌 Découvrez Congés+++ : l’outil interactif pour optimiser vos congés et vos ponts de 2025 à 2035.
Intérêt pour salariés et employeurs
Pour les salariés, l’optimisation du calendrier permet de prolonger le repos sans épuiser trop vite le compteur de congés. Pour l’employeur, l’anticipation est tout aussi importante : planifier les absences liées aux jours fériés et aux ponts garantit la continuité de l’activité et évite les désorganisations de dernière minute.
Calendrier des jours fériés et ponts 2025
- 1er janvier (mercredi) : Nouvel An
- 18 avril (vendredi) : Vendredi saint (Alsace-Moselle uniquement)
- 21 avril (lundi) : Lundi de Pâques
- 1er mai (jeudi) : Fête du travail – possibilité de faire le pont
- 8 mai (jeudi) : Victoire 1945 – possibilité de faire le pont
- 29 mai (jeudi) : Ascension – possibilité de faire le pont
- 9 juin (lundi) : Lundi de Pentecôte
- 14 juillet (lundi) : Fête nationale
- 15 août (vendredi) : Assomption – week-end prolongé
- 1er novembre (samedi) : Toussaint
- 11 novembre (mardi) : Armistice 1918
- 25 décembre (jeudi) : Noël
- 26 décembre (vendredi – Alsace-Moselle uniquement) : Saint Étienne
Calendrier des jours fériés et ponts 2026
- 1er janvier (jeudi) : Nouvel An
- 3 avril (vendredi) : Vendredi saint (Alsace-Moselle uniquement)
- 6 avril (lundi) : Lundi de Pâques
- 1er mai (vendredi) : Fête du travail – week-end prolongé
- 8 mai (vendredi) : Victoire 1945 – week-end prolongé
- 14 mai (jeudi) : Ascension – possibilité de faire le pont
- 25 mai (lundi) : Lundi de Pentecôte
- 14 juillet (mardi) : Fête nationale
- 15 août (samedi) : Assomption
- 1er novembre (dimanche) : Toussaint
- 11 novembre (mercredi) : Armistice 1918
- 25 décembre (vendredi) : Noël – week-end prolongé
- 26 décembre (samedi – Alsace-Moselle uniquement) : Saint Étienne
RTT : réduction du temps de travail
Les RTT (réductions du temps de travail) ne sont pas des congés payés au sens strict, mais ils fonctionnent de façon similaire : ils offrent aux salariés des jours de repos supplémentaires. Ils concernent les entreprises où la durée hebdomadaire dépasse la durée légale fixée à 35 heures.
Quelle différence avec les congés payés ?
Les congés payés sont un droit universel, acquis par tous les salariés, alors que les RTT dépendent de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise. Un salarié à 35 heures n’aura pas de RTT, tandis qu’un salarié travaillant 39 heures par semaine bénéficiera de jours de récupération en compensation.
Cette distinction explique pourquoi certains parlent de jours de repos plutôt que de congés, même si dans la pratique les salariés utilisent souvent le terme “congé RTT”.
Calcul et attribution des RTT
Le nombre de jours de RTT varie selon la durée de travail et les accords collectifs applicables. Par exemple, un salarié travaillant 39 heures par semaine dans une entreprise appliquant la réduction du temps de travail pourra bénéficier d’environ 10 à 12 jours de RTT par an.
Ces jours peuvent être pris :
- soit à l’initiative du salarié, avec l’accord de l’employeur,
- soit fixés par l’entreprise dans un calendrier prédéfini,
- soit répartis entre les deux, selon la convention collective ou l’accord d’entreprise.
Gestion et planification
La prise de RTT obéit à des règles proches de celles des congés payés : demande anticipée, accord de l’employeur, prise en compte des contraintes de service. Toutefois, les RTT sont souvent plus souples, car leur finalité est de réguler la durée du travail.
Pour l’employeur, la gestion des RTT doit être intégrée dans la planification générale des absences aux côtés des congés payés, des jours fériés et des absences exceptionnelles. Une mauvaise organisation peut créer des déséquilibres, notamment lors des périodes chargées.
Congés familiaux et sociaux : maternité, paternité, parental et plus
Au-delà des congés payés, le droit du travail prévoit un ensemble de congés familiaux destinés à accompagner les événements majeurs de la vie personnelle. Ces congés sont encadrés par la loi et s’imposent à l’employeur. Ils constituent un volet essentiel de la protection sociale des salariés.
Congé maternité
Le congé maternité est obligatoire pour la salariée, afin de protéger sa santé et celle de l’enfant. Sa durée est en principe de 16 semaines (6 avant la naissance et 10 après), mais elle peut être allongée en cas de naissances multiples ou de complications médicales. Pendant cette période, la salariée perçoit des indemnités journalières de la Sécurité sociale, souvent complétées par des dispositifs conventionnels.
Le congé paternité et d’accueil de l’enfant
Le congé paternité est ouvert au père ou au conjoint de la mère, qu’il soit salarié du secteur privé ou public. Depuis 2021, il est fixé à 25 jours calendaires (32 en cas de naissances multiples), dont 7 obligatoires immédiatement après la naissance. Ce congé, indemnisé par la Sécurité sociale, peut être fractionné, ce qui offre une souplesse bienvenue aux familles.
Le congé parental d’éducation
Le congé parental permet à l’un des deux parents de suspendre ou de réduire son activité pour s’occuper de l’enfant. Il peut durer jusqu’à trois ans, avec un droit à retour dans l’entreprise. Il n’est pas rémunéré par l’employeur, mais peut donner lieu à une allocation versée par la Caisse d’allocations familiales.
Les absences exceptionnelles
Certains événements de la vie ouvrent droit à des jours de congés exceptionnels, sans perte de rémunération :
- 4 jours pour un mariage ou un PACS,
- 3 jours pour la naissance ou l’adoption d’un enfant,
- 3 jours pour le décès d’un parent proche (plus selon la convention collective),
- 1 jour pour le décès d’un beau-parent.
Depuis 2004, existe également le jour de solidarité, généralement travaillé (souvent le lundi de Pentecôte) ou converti en une journée supplémentaire prélevée sur le compteur de congés ou de RTT.
Intérêt pour les salariés et obligations pour l’employeur
Ces congés familiaux participent à l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Pour les salariés, ils garantissent une protection dans les moments où la vie privée doit primer. Pour l’employeur, ils représentent une obligation légale stricte : tout refus peut être contesté et donner lieu à des sanctions.
Congés spéciaux : sabbatique, sans solde et création d’entreprise
En plus des congés légaux et familiaux, le droit du travail reconnaît certains congés spéciaux qui permettent aux salariés de s’absenter pour des projets personnels ou professionnels. Moins fréquents que les congés payés ou familiaux, ils répondent néanmoins à des besoins croissants de flexibilité et de développement personnel.
Le congé sabbatique
Le congé sabbatique offre au salarié la possibilité de s’absenter de l’entreprise pour une durée comprise entre 6 et 11 mois. Il peut être utilisé pour voyager, se consacrer à un projet personnel ou simplement prendre du recul. Pendant ce congé, le contrat de travail est suspendu et aucune rémunération n’est versée, mais le salarié conserve son lien avec l’entreprise et son droit à réintégration à l’issue de la période. Pour en bénéficier, il faut justifier d’au moins 36 mois d’ancienneté et de 6 ans d’activité professionnelle.
Le congé sans solde
Le congé sans solde repose sur un principe simple : le salarié obtient l’accord de son employeur pour s’absenter, mais ne perçoit aucune rémunération et n’acquiert pas de droits liés aux congés payés. Il n’est pas prévu par le Code du travail mais peut être organisé par les conventions collectives ou les accords d’entreprise. C’est un outil de souplesse souvent utilisé pour des raisons personnelles (voyage, obligations familiales, formation non couverte par un dispositif légal).
Le congé pour création ou reprise d’entreprise
Le congé pour création d’entreprise est destiné aux salariés qui souhaitent se lancer dans l’entrepreneuriat. Il permet de suspendre son contrat de travail pendant une durée maximale d’un an, renouvelable une fois. Le salarié conserve ainsi un filet de sécurité : en cas d’échec du projet, il peut réintégrer son poste ou un emploi similaire. Ce congé est accordé sous réserve de respecter certaines conditions d’ancienneté et d’en informer l’employeur dans les délais prévus par la loi.
Un levier de bien-être et d’innovation
Ces congés spéciaux traduisent une évolution des attentes professionnelles : recherche d’équilibre vie pro/vie perso, volonté d’éviter le burn-out, besoin de donner du sens à son parcours. Pour l’entreprise, accepter ce type d’absence, c’est aussi investir dans la motivation et la fidélisation des collaborateurs.
Outils pratiques pour bien gérer ses congés
La gestion des congés n’est pas seulement une question de droits : elle suppose aussi une bonne organisation. Pour le salarié comme pour l’employeur, disposer d’outils pratiques permet de simplifier les démarches et d’éviter les conflits liés aux absences.
Simulateurs de calcul
Les simulateurs en ligne permettent de connaître rapidement le solde de congés payés restant, ou de vérifier les droits acquis en fonction de la période de référence. Ces outils sont particulièrement utiles pour anticiper la planification des vacances ou vérifier l’impact d’un jour férié.
Modèles de demande de congés
Une demande de congés doit être claire et formalisée. De nombreux modèles existent, qu’il s’agisse d’une lettre classique, d’un formulaire interne ou d’un mail standardisé. Ces supports garantissent une meilleure traçabilité et facilitent la validation par l’employeur.
Exemple de formulation simple :
- Objet : Demande de congés
- Période : du lundi 12 août au vendredi 30 août inclus
- Solde de congés restant : 14 jours
- Validation souhaitée avant : 15 juin
Outils numériques de planification
De plus en plus d’entreprises adoptent des logiciels RH ou des plateformes collaboratives pour centraliser les demandes d’absences. Ces solutions présentent plusieurs avantages :
- suivi en temps réel du planning des congés de l’équipe,
- intégration automatique des jours fériés et des RTT,
- validation rapide par le manager ou la DRH,
- exportation des données vers la paie.
Optimisation des ponts avec Congés+++
Au-delà du calcul des droits, certains outils aident à planifier intelligemment ses absences. C’est le cas de Congés+++, notre simulateur exclusif qui permet d’optimiser les ponts de 2025 à 2035. En visualisant l’emplacement des jours fériés et les meilleures combinaisons possibles, il devient facile de transformer un seul jour posé en un long week-end de quatre jours. Un gain de temps précieux pour les salariés comme pour les employeurs.
Une organisation bénéfique à tous
Pour le salarié, ces outils sont un moyen de sécuriser ses demandes et d’optimiser son équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Pour l’employeur, ils permettent une gestion des absences plus transparente et évitent les situations de surcharge ou de désorganisation.
Congés et obligations de l’employeur
Le droit aux congés ne repose pas uniquement sur la responsabilité du salarié : l’employeur a lui aussi des obligations précises. Celles-ci visent à garantir l’équilibre entre les nécessités de l’entreprise et les droits des salariés.
Droits et devoirs de l’employeur
L’employeur doit accorder les congés payés acquis par ses salariés et veiller à ce que la période légale de prise soit respectée, notamment la période principale entre le 1er mai et le 31 octobre. Il lui revient également d’informer clairement les salariés des dates de congés fixées dans l’entreprise, en respectant le délai de prévenance prévu par la loi ou la convention collective (généralement un mois).
Conditions de refus
Un employeur peut refuser une demande de congés, mais seulement pour des raisons objectives liées au fonctionnement du service. Ces refus doivent rester exceptionnels et justifiés, par exemple :
- surcharge ponctuelle de travail,
- absence simultanée de plusieurs salariés sur un même poste clé,
- impératif de continuité du service (particulièrement dans certains secteurs comme la santé ou les transports).
En revanche, un refus arbitraire ou discriminatoire pourrait être contesté devant le conseil de prud’hommes.
Sanctions en cas de manquement
Le non-respect des obligations liées aux congés expose l’employeur à plusieurs risques :
- versement d’indemnités compensatrices si les congés acquis n’ont pas pu être pris,
- condamnation pour non-respect du Code du travail en cas de contentieux,
- atteinte à la relation de confiance avec les salariés, pouvant peser sur le climat social et la performance de l’entreprise.
Un rôle clé pour la DRH
Dans les grandes entreprises, la gestion des absences est généralement centralisée par la direction des ressources humaines (DRH), qui s’appuie sur des accords collectifs et sur les outils de planification. Le rôle de la DRH est d’assurer la conformité juridique tout en préservant une organisation fluide du travail.
FAQ : vos questions fréquentes sur les congés
À combien de jours de congés payés un salarié a-t-il droit ?
La règle de base est de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables par an (5 semaines).
Le salarié peut-il refuser de prendre ses congés payés ?
Non. Les congés payés sont obligatoires et doivent être pris chaque année. Le salarié ne peut pas demander à être indemnisé à la place, sauf à la rupture du contrat.
Pourquoi le vendredi compte pour deux jours de congés ?
Parce que la loi raisonne en jours ouvrables (du lundi au samedi). Si un salarié pose son vendredi, le samedi est automatiquement inclus dans le décompte, même s’il ne travaille pas ce jour-là.
Pourquoi une semaine de congé équivaut-elle à six jours ?
Pour la même raison : en jours ouvrables, une semaine de congé comprend le samedi, ce qui porte le total à six jours, contre cinq seulement en jours ouvrés.
Quelle est la règle des 5 samedis pour les congés payés ?
Un salarié qui prend cinq semaines complètes de congés voit mécaniquement cinq samedis inclus dans son décompte, car on raisonne en jours ouvrables.
Est-ce que les week-ends comptent dans les congés payés ?
Non, les samedis sont comptabilisés en jours ouvrables, mais ni les dimanches ni les jours fériés ne réduisent le nombre de jours de congés.
Quelle est la nouvelle loi sur les congés payés ?
En 2023, une décision de la Cour de cassation a confirmé que les salariés en arrêt maladie continuent d’acquérir des congés payés, ce qui a modifié durablement la pratique.
Puis-je poser un seul jour de congé payé ?
Oui, c’est possible. Rien n’impose de poser une semaine entière, à condition de respecter les règles internes de l’entreprise.
Puis-je poser un congé payé du jour pour le lendemain ?
En principe non : la loi impose un délai de prévenance, fixé par le Code du travail ou la convention collective (souvent un mois). Mais dans les faits, un employeur peut accepter un départ plus rapide en cas de bonne entente.
Pourquoi est-on payé plus quand on est en congé ?
Ce n’est pas une augmentation de salaire, mais l’effet de la règle du dixième : dans certains cas, l’indemnité de congés payés calculée selon cette méthode peut être légèrement plus favorable que le maintien de salaire.
Sur le même sujet
Articles récents

Gestion portefeuille investissement IA : La méthode

Taxation des milliardaires français : le grand silence

IA générative voyage : la fin du modèle des plateformes

Palonnier de levage : un équipement clé pour sécuriser la manutention industrielle

Taux Livret A : chute à 1,5 %, son plus bas depuis 2022

Trafic web vs conversion : pourquoi 98% de vos visiteurs repartent sans acheter ?

FinTech B2B 2026 : finance embarquée, la révolution PME

Reconversion professionnelle : la formation en ligne qui évite les mauvais paris

Entreprise bicéphale : gérer le duo sans conflit



